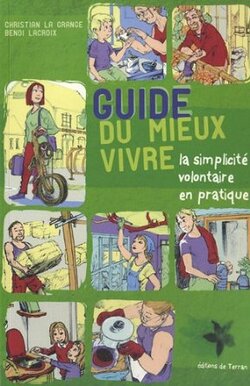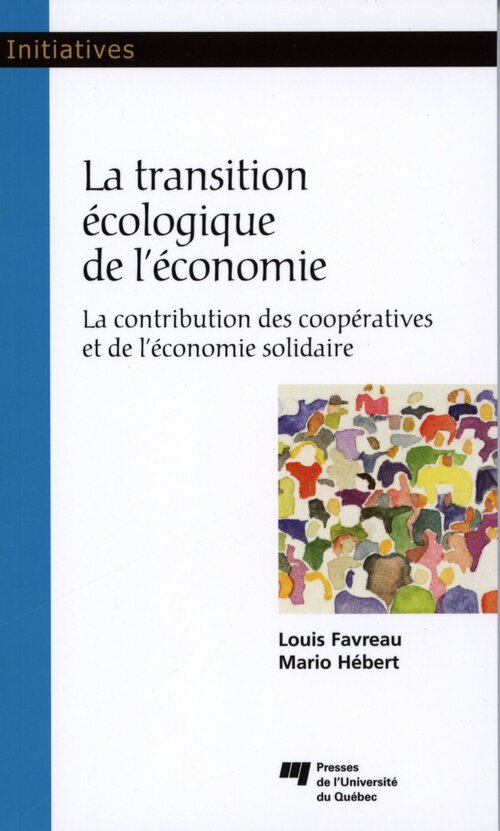Au Nicaragua et au Guatemala, des solutions contre la malnutrition et la pauvreté
Bernard Pinaud, délégué général, était en mission de terrain au Guatemala et au Nicaragua pour évaluer l’avancée de projets soutenus par le CCFD-Terre Solidaire. Il nous livre son témoignage.

© CCFD-Terre Solidaire
Accompagné de Walter Prysthon, chargé du suivi des projets du CCFD-Terre Solidaire en Amérique centrale, je retrouve le Nicaragua avec de nouveau Daniel Ortega à la tête du pays. On est très loin d’une deuxième phase de la révolution sandiniste : nos partenaires nous parlent des difficultés à s’exprimer librement, du contrôle social imposé par des sympathisants sandinistes, de répressions de mouvements sociaux comme celui des retraités, pourtant appuyés par des jeunes.
La politique du gouvernement est libérale et favorise les méga projets comme celui du creusement d’un canal entre les océans atlantique et pacifique pour faire concurrence à celui de Panama. Des dizaines de milliers d’habitants risquent l’expropriation.
Ma mission se concentre sur les activités de l’Union des coopératives à Nueva Guinea (300 kilomètres au sud-est de Managua, la capitale) appuyées par la Fédération nationale des coopératives de producteurs agricoles (FENACOOP), partenaire du CCFD-Terre Solidaire depuis 1999.
Nueva Guinea est une ville de colons. Des migrants internes qui sont venus dans cette zone recouverte, à l’époque, de forêts luxuriantes pour défricher et cultiver la terre ainsi gagnée.
Au début, nous disent les anciens de l’Union des coopératives Ahmed Campos (UCA), on défrichait le plus possible, on achetait le plus possible de terres, on utilisait des pesticides, des engrais chimiques. On voyait grand, on voulait aller vite…
C’est en prenant conscience de la pollution de leur eau par les pesticides et grâce à l’accompagnement de la FENACOOP que, peu à peu, les 172 producteurs de l’UCA se sont tournés vers l’agro-écologie et, donc un mode de culture plus raisonné, voire biologique pour certains produits.
Afin de dégager plus de marge de gains, certains de ces producteurs ont ajouté à leurs cultures traditionnelles (maïs, manioc, haricot) la culture du cacao.
Un centre qui sert à la fois de pépinière, dit « jardin clonal », de 47 variétés de cacaotier différentes sur 21 hectares et de formation des producteurs sur les mécanismes de pollinisation du cacao ou de greffe et d’agroforesterie, a ainsi été mis en place avec le soutien de la FENACOOP. En effet, le cacaotier a sans cesse besoin d’ombre au cours de sa croissance. Il faut donc semer d’autres arbres en même temps que le cacaotier qui vont pousser à des rythmes différents et ainsi accompagner de leur ombre la croissance du cacaotier.
La UCA a aussi construit un centre de stockage qui sert pour la fermentation du cacao - pour dégager l’arôme - avant son séchage.
Cette expérience est très prometteuse d’autant plus que j’ai pu constater les compétences technique et pédagogique des formateurs du « jardin clonal » et du centre de stockage.
Ainsi ces petits producteurs qui vivent, avec leur famille, dans des conditions extrêmement précaires vont voir leurs revenus augmentés dans les années à venir grâce au cacao…grâce à la coopérative et grâce à la FENACOOP !
Autre effet de ces innovations, des jeunes se lancent de nouveau dans la production agricole. Ainsi, la migration des jeunes de la région vers le Costa Rica voisin est en train de diminuer.
Ce dynamisme des producteurs fait ainsi de la UCA un interlocuteur respecté des autres producteurs de la région et une référence pour les autorités de Nueva Guinea.
Le fruit du Ramon contre la malnutrition
Dans l’Ixcan, région au nord du département du Quiché au Guatemala, à la frontière avec le Mexique, notre organisation partenaire SERJUS vient en appui à cinq associations de producteurs, fédérations de coopératives, associations de femmes productrices. Elles sont rassemblées au sein du réseau alternatif d’échanges solidaires en Ixcan (RAIS), et sont pour la plupart un prolongement de la pastorale sociale du diocèse du Quiché. Cette filiation démontre l’impact sur le long terme d’une pastorale socialement engagée.
J’y ai rencontré les responsables et des membres, visité leurs centres de formation, leurs pépinières, leurs centres de stockage de production.
Ainsi, le groupe de femmes Santa Maria de los Dolores a entrepris de revaloriser l’utilisation des fruits d’un arbre local, le Ramon. Ce fruit, semblable à une noisette, largement utilisé par les anciens dans la cuisine, ne servait plus qu’à nourrir les animaux. Et pourtant le Ramon est très nutritif, alors même que le Guatemala a le taux de malnutrition infantile le plus élevé d’Amérique latine.
Ce groupe d’une dizaine de femmes a donc décidé de relancer son utilisation et le transforme en jus pour la boisson, en farine pour des « tortillas » ou des sauces, en gâteaux afin de les vendre sur les marchés. Lors d’un déjeuner chez la présidente du groupe, j’ai pu goûter du Ramon à toutes les sauces. Délicieux !
Puis elle nous a emmenés voir ses « manzanas » (unité de mesure agraire locale) de Ramon. Une heure de marche dans la boue, les maïs et une forêt luxuriante au bout duquel s’élèvent des arbres de plusieurs dizaines de mètres de haut : les fameux Ramons.
Un projet réussi qui permet de faire reculer la malnutrition, en particulier celle des enfants. Le SERJUS compte bien promouvoir avec notre appui le Ramon dans d’autres villages du département du Quiché.
Des communautés de déplacés, vingt ans plus tard
Ce voyage dans l’Ixcan m’a replongé vingt ans en arrière. Alors responsable du Service Amérique latine du CCFD-Terre Solidaire, je m’étais rendu une première fois dans cette région en janvier 1994.
Ce 15 janvier 1994, je me rends dans l’Ixcan où je rencontre les responsables de la communauté Victoria 20 de Enero en pleine installation. Tout est à construire : maisons, postes de santé, latrines, garderies. Tout est à organiser : la production agricole, l’élevage, et ce en coopérative. Cette communauté est constituée d’environ 2500 personnes rapatriés ayant fui 12 ans auparavant la guerre civile pour se réfugier de l’autre côté de la frontière dans le Chiapas mexicain. Le CCFD les soutient pour reconstruire leur vie.
Après 6 ans de négociation, l’accord de paix allait être signé le 26 décembre 1996. Cet accord a permis la fin d’un conflit entre l’armée et les guérillas qui aura fait en trente ans plus de 150 000 morts (dont 80% de mayas), un million de déplacés internes et 250 000 réfugiés en particulier au Mexique.
Février 1997, je me rends à nouveau dans l’Ixcan, cette fois pour rencontrer les responsables d’une autre communauté qui s’est installée depuis un an grâce à des financements trouvés par le diocèse du Quiché : la communauté Primeravera del Ixcan. 2000 personnes déplacées internes, des indigènes qui se sont réfugiées pendant dix ans au cœur de la forêt pour fuir la répression militaire, ses mitraillages. Je suis impressionné par leur niveau d’organisation et l’effervescence autour de nous : tout le monde s’active pour poser une charpente de la nouvelle école, creuser un fossé pour les futures canalisations, etc. Ils s’organisent en coopérative mais chacun a aussi son lopin de terre et un petit élevage pour l’alimentation familiale. Une dizaine d’étrangers vivent avec eux pour les protéger des représailles de l’armée. Là aussi, le CCFD les soutient pour cette installation.
2013. L’Ixcan a bien changé en vingt ans, de nombreuses infrastructures ont vu le jour : routes bitumées, ponts construits, électricité jusque dans des villages éloignés. Mais la pauvreté est toujours là.
Cette transformation va s’accélérer car, au bord de la route, nous voyons de grandes étendues de terre où poussent des palmiers d’Afrique pour l’huile de palme, des conduits de pétrole, et on nous parle de barrages hydrauliques à venir. Et sur les poteaux électriques de la publicité pour Bayer, Monsanto ou Sygenta. Les méga projets se développent dans l’Ixcan et transforment l’économie locale et la vie sociale à un rythme effréné.
De nouveaux acteurs sociaux se mobilisent face aux dégâts environnementaux, aux risques que comporte la monoculture pour la sécurité alimentaire. Mais le rouleau compresseur continue d’avancer.
Dans les réunions avec les responsables des associations ou fédérations de coopératives accompagnées par notre partenaire SERJUS, je retrouve des représentants de Victoria 20 de Enero et de Primeravera de l’Ixcan. Leurs installations ont réussi, leurs coopératives sont très bien structurées et économiquement les plus efficaces du département. Quand ils prennent la parole, je reconnais l’élan de la résistance et le dynamisme des pionniers que j’avais entendu il y a vingt ans !
Le procès de l’ancien dictateur Rios Montt
Dès notre première journée au Guatemala, nous sommes plongés, Walter Prysthon, notre chargé de mission pour l’Amérique centrale, et moi, dans l’actualité. En effet, notre organisation partenaire ODHAG, le Bureau de défense de droits de l’homme de l’Archidiocèse de Guatemala Ciudad, a organisé une réunion pour nous permettre d’analyser le procès de l’ancien dictateur Rios Montt.
Sont présents des représentants de l’organisation de droits de l’homme CALDH qui s’est portée partie civile, leur avocat dans l’affaire, et une responsable de notre organisation partenaire Actoras de cambio (Actrices de changement) qui a accompagné les femmes victimes de viols commis par des militaires, et qui ont accepté de témoigner pendant le procès.
Les pires atrocités de cette guerre civile se sont déroulées en 1982 et 1983 quand Rios Montt était au pouvoir.
Grâce à la levée du secret défense sur quatre documents détaillant les opérations militaires d’alors, le CALDH a pu intenter un procès contre le général Rios Montt pour « génocide » contre la population Ixile.
L’ouverture de ce procès le 19 mars 2013 était un moment attendu depuis quinze ans par les organisations de droits humains. Rios Montt y était jugé pour le massacre de 1 771 indiens de l’ethnie maya des Ixiles dans le département du Quiché.
Contre toute attente, le tribunal a condamné le 10 mai l’ancien général Rios Montt à 80 ans de prison dont 50 pour génocide et 30 pour crimes contre l’humanité. Un verdict sans précédent pour une justice nationale. En effet, c’était la première fois qu’une condamnation pour génocide était prononcée par un tribunal national et non international comme ce fut le cas pour l’ex-Yougoslavie ou le Rwanda.
Lors de ce procès, des femmes violées par des militaires ont décidé de témoigner. Elles avaient demandé à ce que cela soit à huis clos, ce qui fut refusé par le tribunal. Ces « survivantes » (c’est le nom qu’elles se donnent) ont alors décidé de témoigner publiquement, le visage masqué par leurs tissus colorés d’indigènes, mais leur nom était connu. Pleines de courage, elles ont rapporté les viols collectifs, les ventres de femmes enceintes ouverts à l’arme blanche, les exécutions sommaires.
Mais, dix jours après l’annonce du verdict, la Cour constitutionnelle annulait la décision par 3 voix contre 2, non pas sur le contenu même mais sur la procédure, suspendant ainsi le jugement.
L’avocat de la CALDH nous explique avec précisions toutes les phases du procès, ses rebondissements, les 110 vices de forme déposés par la défense du général et ses 6 démarches saisissant la cour constitutionnelle.
De toute évidence, il y a eu des pressions de la part du gouvernement, de militaires voire de certains chefs d’entreprise, non pas tant pour défendre le général Rios Montt dont la responsabilité dans les massacres n’est pas remise en cause, mais pour éviter que le génocide soit reconnu.
Malgré l’annulation de la décision du tribunal, Albertina d’Actoras de cambio nous affirme que les femmes mayas qui ont témoigné ne sont pas déçues, « Voilà, c’est fait ! », disent-elles fièrement.
Pendant tout le temps du procès, une recrudescence de menaces et d’assassinats de défenseurs de droits de l’homme a eu lieu, ainsi que contre l’Eglise guatémaltèque et des organisations catholiques étrangères comme le CCFD-Terre Solidaire accusées par la « Fondation contre le terrorisme » (constituée d’anciens militaires du temps de la guerre civile) de financer le « terrorisme ».
Ces accusations ne nous impressionnent pas et nous allons continuer à appuyer nos partenaires guatémaltèques qui luttent courageusement, au péril de leur vie, pour la promotion des droits humains, en particulier des femmes mayas !
Bernard Pinaud Juillet 2013
 Ni pollution, ni pétrole, ni pesticide. La permaculture apporte des réponses détonantes aux critiques faites à l’agriculture conventionnelle. Elle permet de cultiver beaucoup sur une petite surface, le tout en créant de véritables éco-systèmes cohérents et auto-fertiles. En Australie, en Autriche et en Amérique du Nord les exemples se sont multipliés ces dernières années. Oui, mais cette permaculture permet-elle aux agriculteurs de vivre convenablement de leur travail ?
Ni pollution, ni pétrole, ni pesticide. La permaculture apporte des réponses détonantes aux critiques faites à l’agriculture conventionnelle. Elle permet de cultiver beaucoup sur une petite surface, le tout en créant de véritables éco-systèmes cohérents et auto-fertiles. En Australie, en Autriche et en Amérique du Nord les exemples se sont multipliés ces dernières années. Oui, mais cette permaculture permet-elle aux agriculteurs de vivre convenablement de leur travail ?